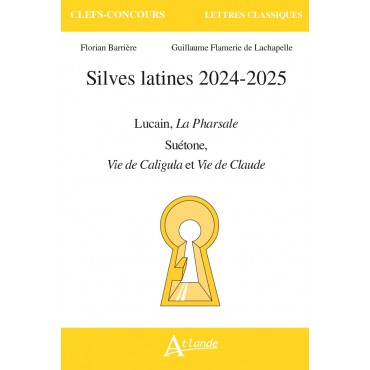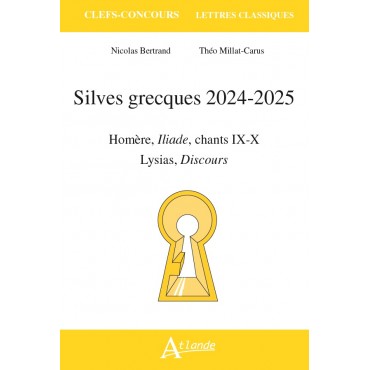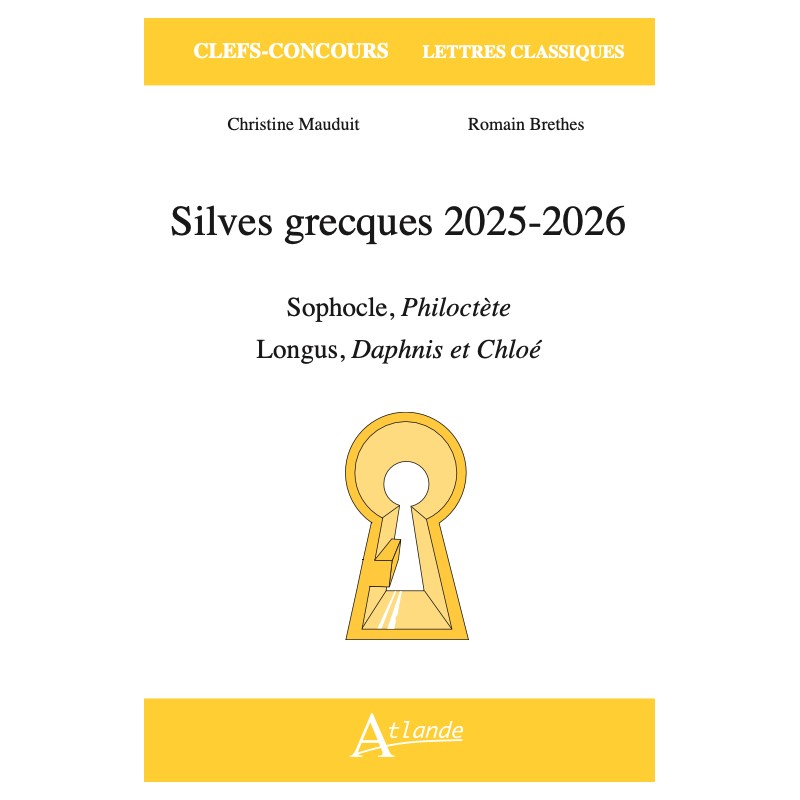
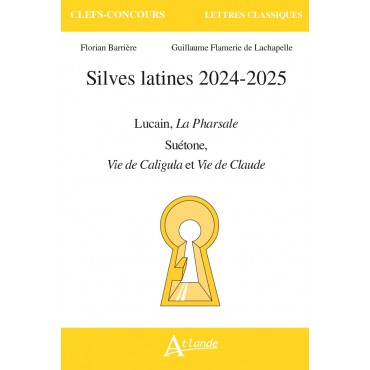
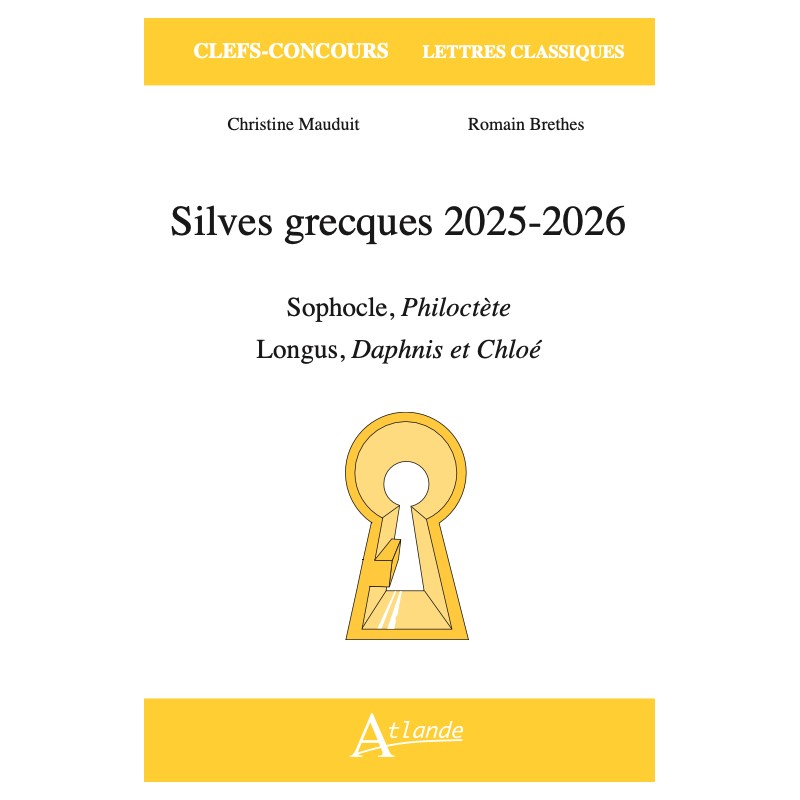

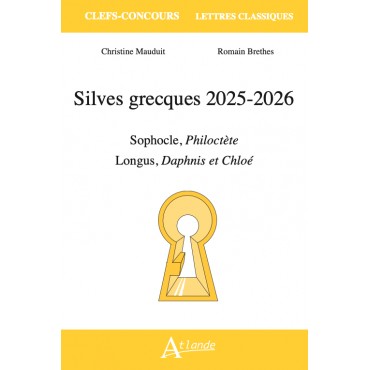
par Christine Mauduit et Romain Brethes
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. & monde : 3€ jusqu'à 25€, 6€ jusqu'à 50€, 9€ jusqu'à 100€, 12€ au-delà 100€ DOM-TOM : 8€
Traitant des nouveaux éléments du programme de grec des agrégations externe de Lettres classiques et de Grammaire, l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les clefs-concours Lettres classiques, l’ouvrage est composé de deux parties consacrées à chacune des deux nouvelles œuvres au programme, elles-mêmes subdivisées en Repères, Problématiques et Boîte à outils.
Fiche technique
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
REPÈRES
SOPHOCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La vie de Sophocle : quelques jalons. . . . . . . . . . . . . . . .. .19
Carrière théâtrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Sophocle et l’art tragique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
LE MYTHE DE PHILOCTÈTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Le mythe de Philoctète dans l’épopée et la poésie lyrique. .25
Philoctète sur la scène attique avant Sophocle . . . . . . . . . .28
LE PHILOCTÈTE DE SOPHOCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Les circonstances historiques de la représentation : 409 av. J.-C. . .32
Les innovations de Sophocle . . . . .34
LA COMPOSITION DU PHILOCTÈTE . . . .37
Quelques remarques sur la structure. .40
QUESTIONS DE MISE EN SCÈNE . . . . . . .43
L’espace théâtral . . . . . . . . . . . . . . .43
Le dispositif scénique du Philoctète. .47
Costumes et objets scéniques . . . . .50
PROBLÉMATIQUES
ESPACE DRAMATIQUE ET DYNAMIQUES SPATIALES. . . . . . . . .55
Le lieu de l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
La Lemnos de Sophocle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
La solitude de Philoctète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
L’environnement sauvage de l’île . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Les autres pôles spatiaux de la tragédie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Chrysè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
La patrie de Philoctète et le thème du nostos oikade . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Troie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Actualisation scénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
CRISES SUR LA SCÈNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Des mots sur un mal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Points de vue sur un abandon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Conceptions de la maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
La mise en scène de la maladie et du corps souffrant . . . . . . . . . . .71
La boiterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Les cris et la crise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
La maladie et le cours de l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Le problème de la pitié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
La crise de conscience de Néoptolème et le rejet du dolos . . . . . . . . . . . . .76
L’horizon de la guérison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
LES POUVOIRS DU LOGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Philoctète : le désir du logos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Dolos et mensonge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Les faux récits troyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
La persuasion sans apatē . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Les muthoi d’Héraclès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
BOÎTE À OUTILS
ÉLÉMENTS DE MÉTRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Rappels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Correptio attica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Phénomènes d’adaptation des mots au cadre métrique . . . . . . . . . . . . . . .101
Les parties parlées du Philoctète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Le trimètre iambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Le tétramètre trochaïque catalectique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Les passages en récitatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Dimètres anapestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Hexamètres dactyliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Les partieslyriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Principes de composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Remarques sur les parties chantées du Philoctète . . . . . . . . .. . . . . . . . .112
TEXTES COMPLÉMENTAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
1.Homère, Iliade, II, 716-726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
2. Homère, Odyssée, III, 188-190 . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
3. Homère, Odyssée, VIII, 219-220 . . . . . . . . . . . . . . . .116
4. Chants cypriens, résumé de Proclos . . . . . . . . . . . . . .116
5. Petite Iliade, résumé de Proclos . . . . . . . . . . . . . . . . .116
6. Pindare, Ire Pythique, v. 50-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
7. Dion de Pruse, Discours LII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
LEXIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Christine Mauduit est professeur de langue et littérature grecques à l’ENS-PSL. Ses travaux portent sur le théâtre grec. Dans le présent volume, elle a rédigé les pages sur le Philoctète de Sophocle.
Romain Brethes est professeur de langues et cultures de l’Antiquité en classes préparatoires au lycée Janson-de-Sailly et à Sciences Po. Dans le présent ouvrage, il a rédigé la partie portant sur le Daphnis et Chloé de Longus.
À l’époque moderne, ce sont Les Aventures de Télémaque de Fénelon (1699) qui marquent la véritable renaissance du mythe de Philoctète: au livre XII, Philoctète y raconte son histoire à Télémaque, pour lui expliquer l’origine de sa haine contre Ulysse, en des termes qui sont directement inspirés du Philoctète de Sophocle. Le regain d’intérêt pour Philoctète qui marque le XVIIIe siècle, non seulement en France, avec les Philoctète de Chateaubrun (1756), La Harpe (1783) et Ferrand (1786), mais aussi en Angleterre et en Allemagne, est indissociable de la multi- plication, à cette époque, des traductions de la pièce de Sophocle dans différentes langues européennes. Philoctète est également une figure prééminente dans le Laocoon de Lessing (1766). Lessing pose, à travers lui, la question de la représentation de la souffrance dans l’art, qui est alors, en Allemagne en particulier, le lieu d’un vif débat, animé également par Winckelmann et Herder. La pièce et le personnage de Sophocle sont donc à cette époque au cœur de débats esthétiques, qui tournent autour de la question de savoir si l’œuvre d’art doit permettre ou au contraire, contenir l’expression de la douleur, et si des réponses différentes ne doivent pas être données à cette question en fonction des arts considérés. Après une éclipse au XIXe siècle, dans laquelle le Philoctète ou le Traité des trois morales de Gide, paru en 1898 dans la Revue Blanche, fait figure d’exception, la seconde moitié du XXe siècle marque le retour en force de Philoctète sur la scène, avec de nombreuses productions de la pièce de Sophocle, et différentes réécritures ou adaptations, qui font entrer la trajectoire tragique de Philoctète en résonance avec les soubre- sauts de l’histoire contemporaine. L’une des plus marquantes de ces réappropriations est le Philoktet du dramaturge est-allemand Heiner Müller (1965), une pièce sombre, pessimiste, qui démythifie et déshé- roïse les personnages de Sophocle et qui “met à mal la lecture idéaliste de l’Antiquité grecque élaborée par le classicisme allemand” [HUMBERT- MOUGIN, 2018, § 10] ; ce Philoktet sans chœur et sans dieux s’achève sur le meurtre du héros, poignardé dans le dos par Néoptolème; Ulysse invente sur-le-champ une version officielle de l’histoire, pour la servir à l’armée grecque. On est loin de l’univers de Sophocle.