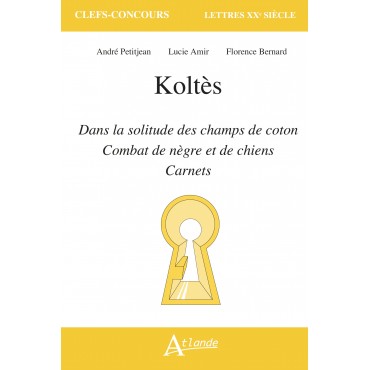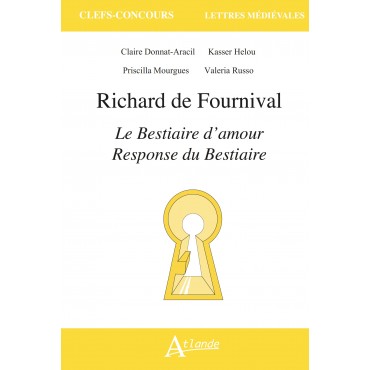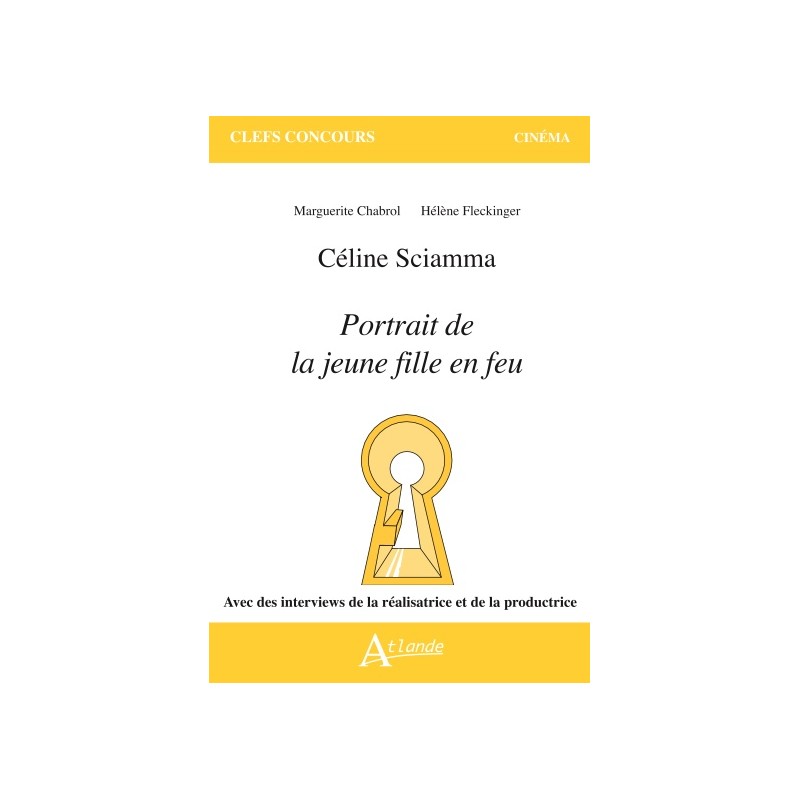
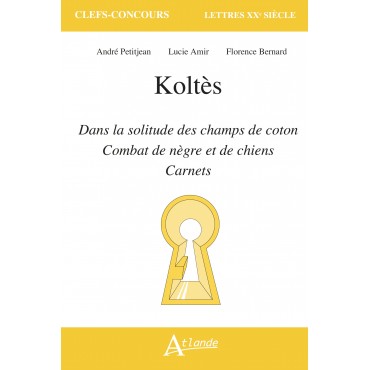
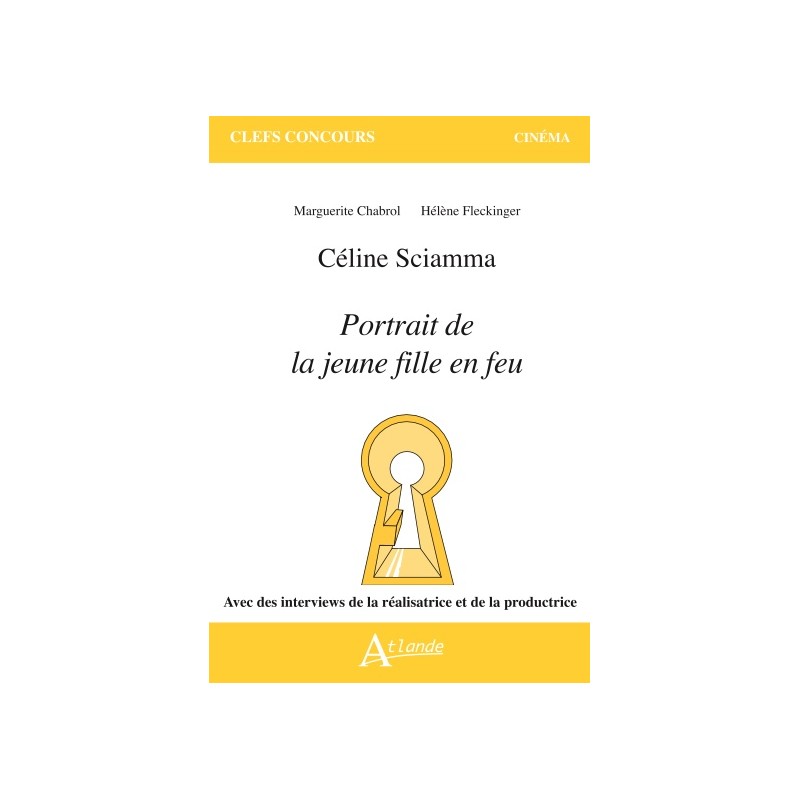
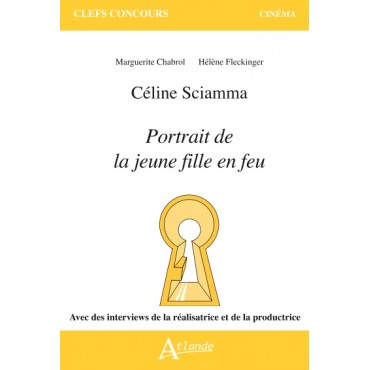

par Hélène Fleckinger et Marguerite Chabrol
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. & monde : 3€ jusqu'à 25€, 6€ jusqu'à 50€, 9€ jusqu'à 100€, 12€ au-delà 100€ DOM-TOM : 8€
Traitant de l’œuvre cinématographique au programme 2025 des agrégations internes de Lettres classiques, Lettres modernes et CAERPA, l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat.
Comme tous les Clefs-concours de Lettres cinéma, l’ouvrage est structuré en quatre parties :
Fiche technique
Introduction : un film pré-révolutionnaire ? 11
REPÈRES
Un film d’autrice
Politique de l’autrice 20
Un film de maturité 25
Une méthode d’écriture par scènes 27
Récit d’une production 29
Étude de réception :
un triomphe international et des nuances d’interprétation
Une circulation internationale de grande ampleur 35
Un mélodrame, un style classique, un film politique ? 37
Un film queer 45
Un manifeste du female gaze ? 48
Éléments génétiques : des scénarios au film
Un souci d’exactitude historique 54
Épure et cohérence formelle 55
Accentuation du slow burner 60
Atténuation du fantastique 63
THÉMATIQUES
Une dramaturgie sans conflit ? Les rythmes du désir
Parenthèses dans la parenthèse 71
Cohérence formelle :
le mythe d’Orphée et le motif du retournement 76
L’art de l’attente 78
Le rythme du dialogue 80
Moments musicaux 83
Superposition des temporalités 87
Dispositifs de regards
Les limites de la notion de female gaze 94
La réflexivité entre geste d’autrice et démarche féministe 97
Réversibilité du regard 100
Variations sur le champ / contrechamp 102
L’invitation au regard : la place du public 108
Poésie du gothique
Une dimension programmatique ? 118
Valeurs expressives : la peur 122
De l’inerte au vivant : le motif du voile 125
Le gothique féminin : une critique du mariage 127
La romance gothique : dialogue avec Jane Campion 132
Inventer des “images manquantes” : entre Histoire et fiction
L’invention d’une protagoniste de la “parenthèse enchantée” 140
“Inventer notre 2018e siècle” 143
Au-delà de la convention du portrait 145
Jeunes filles en feu 148
Liberté, égalité, sororité 152
La fiction comme utopie réalisée 156
OUTILS
Entretiens
Entretien avec Céline Sciamma 163
Entretien avec Bénédicte Couvreur 183
Séquencier commenté 195
Fiche technique 215
Filmographie de Céline Sciamma 219
Bibliographie 221
Glossaire 231
Cahier iconographique 237
Hélène Fleckinger est maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’Université Paris 8.
Marguerite Chabrol est professeure en étude cinématographiques à l’Université Paris 8.
Associé à l’une des cérémonies les plus houleuses du cinéma français, les César de février 2020, Portrait de la jeune fille en feu est plus que jamais apparu comme un rôle sur mesure pour Adèle Haenel, dont la colère a alors éclaté publiquement, et un film politique clairement associé à la dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Cet événement et ses conséquences ont exacerbé deux caractéristiques fondamentales du film – c’est bien un rôle sur mesure et un film politique – mais peut-être en en simplifiant les enjeux. Le moment auquel Portrait reste beaucoup lié en France et les prises de position publiques de sa réalisatrice dissimulent aussi le temps long du projet, conçu bien avant que le mouvement #MeToo ne se soit développé. Cela n’empêche pas – et peut même expliquer – son importance comme film culte, comme emblème de luttes féministes, réapproprié notamment sur les réseaux sociaux par de nombreux commentaires et mèmes. Le film est aussi en partie devenu un objet “pop”, inscrit dans une culture populaire francophone et surtout anglophone. Il est cité dans des chansons comme celle que Jeanne Cherhal a écrite pour Julien Clerc, “La Jeune Fille en feu”. L’imagerie du feu, qui circule de scène en scène et qui est plus largement attachée au film ne serait-ce que par son titre et ses visuels, confirme aux yeux de beaucoup son statut de film révolutionnaire, ou de film-symbole d’une révolution.
Mais réduire Portrait à sa réception revient souvent à en laisser de côté la richesse et le souffle propres. Le film n’est initialement pas un projet militant et, comme le souligne Adèle Haenel, “Céline Sciamma mélange de façon exceptionnelle le romanesque et l’intellectuel.” [Haenel et Merlant, 2019]. Le choix du film pour le programme des agrégations de lettres invite à explorer ces enjeux en dépassant le symbole et répond en France au manque relatif de travaux académiques consacrés à la réalisatrice. S’il existe encore peu de publications en français, la filmographie de Céline Sciamma est au contraire déjà très représentée dans les colloques et publications anglophones, où sa reconnaissance est sans équivoque.