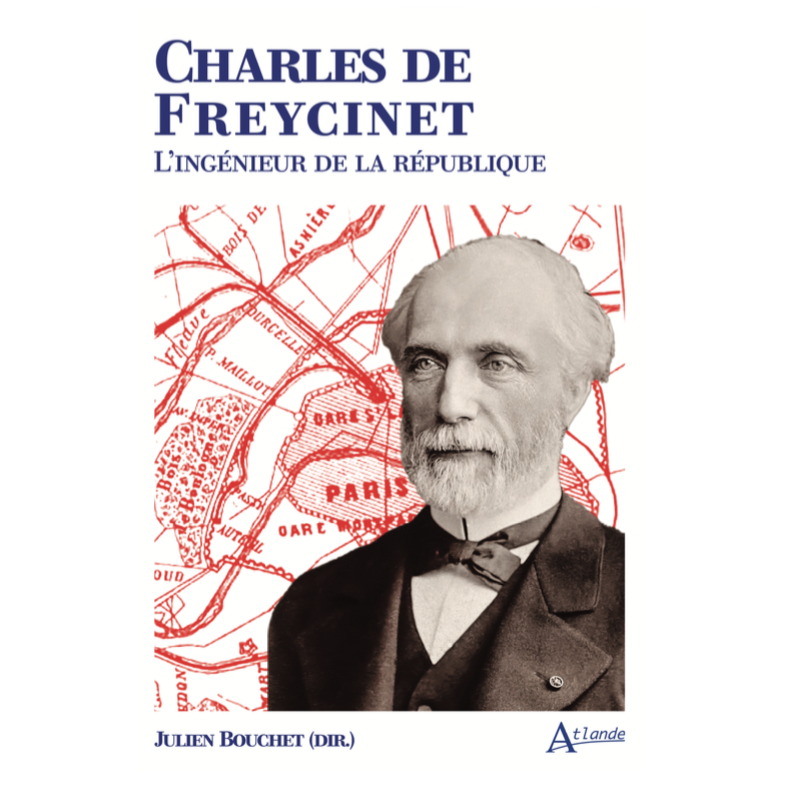
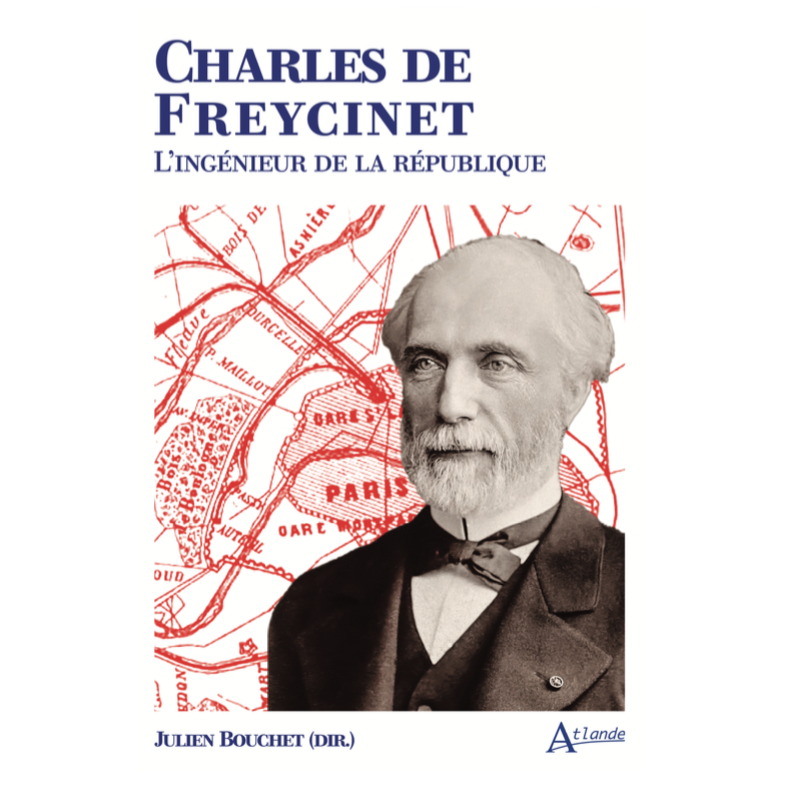
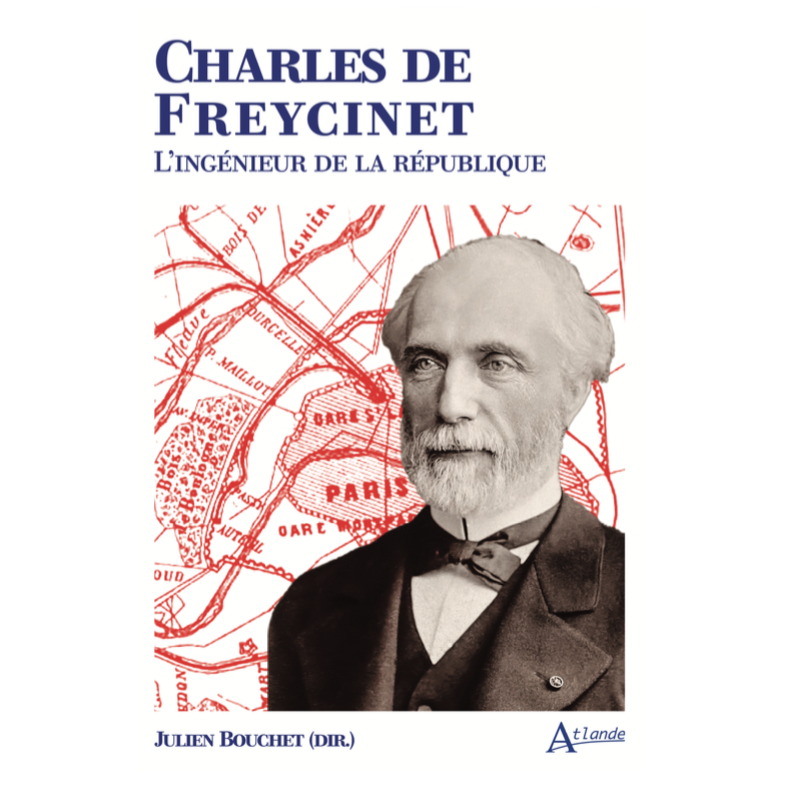
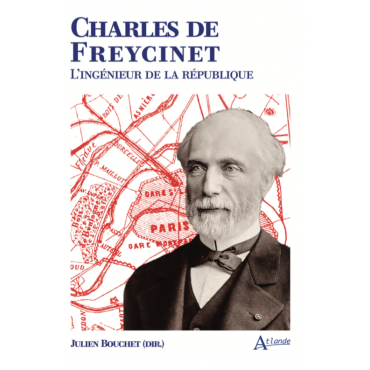

Par Julien Bouchet (dir.)
 Livraison en lettre suivie
Livraison en lettre suivie
France met. & monde : 3€ jusqu'à 25€, 6€ jusqu'à 50€, 9€ jusqu'à 100€, 12€ au-delà 100€ DOM-TOM : 8€
On doit à Freycinet le réseau de chemins de fer français dont il a conçu le plan ainsi que celui des canaux, dont il a fixé le gabarit. Après avoir consacré un volume à l’homme politique, Julien Bouchet s’attache à l’ingénieur, à ses réalisations mais aussi à la façon dont il s’est formé, dont il a entretenu ses réseaux et a, toujours avec un esprit d’ingénieur, exercé ses responsabilités. L’auteur nous plonge dans une des époques les plus glorieuses de l’École polytechnique, dans une École des Mines en pleine mutation et dans l’atmosphère très moderniste du corps des Ponts et Chaussées. Durant sa carrière politique d’une longévité exceptionelle, Freycinet n’a pas seulement fait entrer la France des transports dans la modernité, il a aussi été le précurseur de l’aménagement du territoire, l’artisan de la renaissance de la Marine nationale et le créateur des services de renseignements français. Cet ouvrage change de focale par rapport à Charles de Freycinet, Bâtisseur de la République, exclusivement centré sur l’arène politique de l’époque.
Fiche technique
SOMMAIRE
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
PREMIÈRE PARTIE : LES MARQUEURS
Archives et mémoire de Charles de Freycinet
à l’École polytechnique : l’héritage de sa fille . . . . . . . . . . . 25
La composition du fonds d’archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Un legs pour aider financièrement les étudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Un legs complété de souvenirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Freycinet dans les histoires de l’École publiées au XIXe siècle . . . . . . . 34
Les obsèques de Freycinet et l’intégration des souvenirs
dans les collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
La commémoration du centenaire de la naissance . . . . . . . . . . . . . . . . 38
La mémoire de Freycinet jusqu’à la guerre, à l’École
et dans les associations d’anciens élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
La pérennisation de la mémoire de Freycinet
dans l’enceinte de l’École polytechnique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Freycinet sous la Ve République, à l’École
et dans les associations d’anciens élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
X1846 : Charles de Freycinet
et sa promotion de Polytechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Le marathon du concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Une bonne représentation des provinces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
La prédominance des classes supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Une scolarité cloîtrée et intensive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
La rupture de février 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Le bricolage d’un classement de sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Des carrières très inégales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Charles de Saulces de Freycinet, élève ingénieur
à l’École des mines de Paris (1848-1852) . . . . . . . . . . . . . . 73
La formation de l’élève ingénieur à l’époque de Freycinet . . . . . . . . . . 75
• Réorganisation des enseignements : la réforme de 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
• Les voyages dans la formation pratique de l’ingénieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Une image vivante de l’industrie extractive du milieu du XIXe siècle . . 82
• Observation des progrès techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
• Considérations économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
• Observation du travail ouvrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Les voyages : un aperçu du métier et du rôle
de l’ingénieur du Corps des mines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
• L’ingénieur géologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
• Les sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
• S’insérer dans un réseau d’ingénieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
DEUXIÈME PARTIE : LES RÉSEAUX ET EMPREINTES TECHNIQUES
Les X-Ponts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Un grand corps conducteur du Progrès en province . . . . . . . . . . . . . . 98
Un corps paradoxal, entre dynasties et méritocratie,
service de l’État et anticonformisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
La formation, l’apprentissage et la carrière d’un ingénieur des Ponts,
entre vie privée et travaux publics, 1858-1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les accès de fièvre hexagonale d’un corps technique :
la guerre de 1870, la crise de 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
La clé de voûte et le sommet d’un corps :
galerie de portraits au Conseil général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Le plan Freycinet, un acte majeur
de la défense républicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Le spectre de la nationalisation ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
La solidarité républicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
L’accord des deux ministres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Un financement original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Les bénéfices de la haute banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Le plan Freycinet, l’invention d’une politique républicaine
d’“aménagement du territoire” ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Les objectifs politiques et économiques du plan Freycinet . . . . . . . . . 129
• Un double objectif politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
• Un double objectif de politique économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Une vision républicaine de l’aménagement du territoire . . . . . . . . . . . 134
Un tremplin pour la carrière politique de Freycinet . . . . . . . . . . . . . . 137
Charles de Freycinet en charge du plan d’outillage national :
de l’impulsion politique à l’abandon budgétaire . . . . . . . . 143
Introduction : un “ingénieur des mines” raté ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
L’initiative de Dufaure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Printemps 1878 : le lancement du programme d’outillage national . . 148
Automne 1878 : des tournées triomphales de promotion . . . . . . . . . 150
1879, les plans sont votés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
En marge du programme, la constitution d’un réseau d’État . . . . . . . 152
Quelques critiques à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Par-delà le plan… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Financement : jusqu’à 10 % des dépenses de l’État . . . . . . . . . . . . . . 157
Mais une récession imprévue… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Quelques bilans rétrospectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
TROISIÈME PARTIE : LES EMPREINTES PARLEMENTAIRES
ET POLITIQUES
Le sénateur Freycinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Avant l’entrée au Sénat : plusieurs échecs en province,
la reformulation d’un positionnement politique
et une campagne réussie dans la Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Un sénateur actif et réélu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Le travail parlementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Au Sénat, une présence continue à partir de 1893 . . . . . . . . . . . . . . . 183
• En séance : une discrétion efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
• Un président de commissions : la compétence respectée . . . . . . . . . . . . . . . 185
• Gérer la mémoire de ses actions ministérielles : la sagesse de l’expérience . 186
• Un “sous-ministériat” permanent de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
La République et ses ennemis : la loi du 22 juin 1886
ou les derniers feux royalistes et bonapartistes ? . . . . . . . . 193
Charles de Freycinet, figure de la lutte
contre les forces conservatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
• Le danger royaliste et bonapartiste : entre réalités et exagérations . . . . . . . 195
• De la modération à la radicalisation : les justifications théoriques et historiques
de la loi d’exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Charles de Freycinet, un fin tacticien
dans la fabrique de cette loi d’exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
• À la recherche d’un équilibre parlementaire… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
• … face à des fronts d’opposition nombreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Charles de Freycinet et les lendemains de la loi d’exil . . . . . . . . . . . . 207
• “Le départ des prétendants ne provoqua pas d’émotion” . . . . . . . . . . . . . . . 207
• L’ambiguë question de l’armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Charles de Freycinet, un artisan pragmatique,
mais modéré de la loi d’exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Freycinet et la Marine : l’ingénieur d’une République armée
sur les mers ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Le ministère de la Marine et des Colonies dans les cabinets
dirigés par Charles de Freycinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
• Un ministère technique, de second rang, confié à des experts . . . . . . . . . . . 216
• La délicate question de l’administration des colonies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
La politique navale menée par les cabinets Freycinet . . . . . . . . . . . . . 221
• La question budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
• Les choix dans la constitution de la flotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
La marine entre les mains de Charles de Freycinet . . . . . . . . . . . . . . . 225
• La marine comme arme de pénétration économique :
l’exemple de la Tunisie en 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
• La marine comme outil de police internationale : l’Égypte en 1882 . . . . . . . 228
Freycinet, l’inventeur oublié du renseignement français ? 235
Freycinet et le renseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Freycinet, homme du renseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Freycinet et le renseignement de son temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
QUATRIÈME PARTIE : LA POLITIQUE DIPLOMATIQUE
ET RELIGIEUSE, UN SILLON ?
Le rapprochement franco-russe, d’après les mémoires
de Charles de Freycinet et d’Alexandre Ribot (1890-1893) 257
Des premières négociations à l’accord diplomatique d’août 1891 . . . 260
La délicate ratification de la convention militaire . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Charles de Freycinet et les congrégations religieuses :
l’échec d’une politique de conciliation (1880) . . . . . . . . . . 275
“Pourquoi des décrets ?” (mars-juin 1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Le “quart d’heure de grâce” (juillet-août 1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Le scandale de la Déclaration (août-septembre 1880) . . . . . . . . . . . . . . 285
La chute du gouvernement Freycinet (septembre 1880) . . . . . . . . . . . 291
CONCLUSION GÉNÉRALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Docteur en Histoire, professeur agrégé d’Histoire, spécialiste de l’histoire moderne de France et enseignant à l’Université de Clermont-Auvergne, Julien Bouchet est auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Atlande, dont Charles de Freycinet, Bâtisseur de la République, Résister à la Shoah, Laïcité chérie, La République irréductible, La belle époque : Citoyenneté, République, Démocratie et Émile Combes et le combisme.
Il a réuni autour de lui une équipe de spécialistes de la période afin d’explorer les différentes facettes de ce personnage fascinant : Pierre Allorant (professeur d’histoire du droit et des institutions, université d’Orléans), Gérald Arboit (historien du renseignement, Sorbonne-Identités). Olivier Azzola (responsable du Centre de ressources historiques et du Mus’X)., Walter Badier (maître de conférences en histoire contemporaine, université d’Orléans), Jean-Félix de Bujadoux (chercheur associé au Centre Maurice Hauriou), Amélie Dessens (conservatrice en chef, bibliothèque Mines Paris), Jean Garrigues (ancien président du Comité d’histoire parlementaire et politique), Hervé Joly (chercheur au Laboratoire Triangle), Benoît Letellier (EPHE), Pierre Morel (Paris I), Georges Ribeill (historien des réseaux ferrés), Romy Sutra (historien du droit, université Toulouse Capitole).
Le nom de Charles de Freycinet est bien sûr associé au plan de
construction ferroviaire et portuaire sans précédent qu’il présenta le
3 janvier 1878 en tant que ministre des Travaux publics du gouvernement
dirigé depuis le 13 décembre 1877 par Jules Dufaure,
proche d’Adolphe Thiers et l’une des figures du Centre gauche.
Ce plan ambitieux prévoit l’achèvement de 3000 kilomètres de voies
ferrées, la construction de 10 000 kilomètres de voies nouvelles,
ainsi que l’aménagement de ports, rivières et canaux, soit un coût
évalué à 4,5 milliards de francs159. Et c’est justement sous cet angle
du financement que cette communication se propose de traiter la
mise en oeuvre de cet ambitieux projet, fruit du rapprochement
entre, d’un côté, Freycinet et son mentor Léon Gambetta et,
de l’autre, Léon Say, autre figure du Centre gauche, ministre des
Finances du gouvernement Dufaure, et par ailleurs proche
conseiller de l’homme d’affaires Alphonse de Rothschild. Leur
entente est indispensable pour réussir le lancement de ce plan qui
vise à relancer l’économie française, alors en grande difficulté,
embourbée dans la crise de l’économie mondiale depuis 1873.
“Monsieur Freycinet pense avec raison que les républicains ont à
prouver qu’ils peuvent aussi bien que n’importe quel autre gouvernement
maintenir l’ordre et qu’ils sont en mesure, mieux peut-être
que leurs devanciers, de favoriser les intérêts matériels, de
développer le commerce et l’industrie et d’exécuter de grands
travaux publics”, lit-on dans l’éditorial de La République française,
le journal de Gambetta, le 12 août 1878. C’est dire que le
plan Freycinet constitue un enjeu politique majeur pour consolider la
République dans l’esprit des Français.
Or le financement d’un plan aussi ambitieux ne peut s’appuyer
que sur de vastes emprunts publics, dont les milieux financiers
devront se porter garants. Sans le soutien de la haute finance et de
la Bourse, donc de Rothschild et de ses amis, le plan Freycinet est
condamné à l’échec. Sans la collaboration du Centre gauche, les
financiers et les boursiers ne s’engageront pas dans une opération
aussi risquée. On se souvient que les emprunts de libération de
1871-1872 avaient été largement garantis par les banquiers,
notamment les proches du Centre gauche de Thiers et Léon Say.
Cette fois, c’est à nouveau leur garantie politique et financière qui
peut assurer le succès du plan Freycinet. Comme il a joué un rôle
essentiel dans le combat politique pour installer la Troisième
République, le Centre gauche tient entre ses mains les conditions de
la relance économique. L’interventionnisme et l’investissement
massif requis par ce plan monumental sont aux antipodes des
principes financiers affichés par Léon Say et ses amis. Pourtant,
un certain nombre de paramètres, aussi bien économiques que
politiques, vont les pousser à s’engager dans ce premier grand projet
de la Troisième République.